jeudi 8 janvier 2009
Par Gilles Jobin,
jeudi 8 janvier 2009
:: Définitioneries
Économiste : Nostradamus avec chiffrier.
aucun commentaire
:: aucun trackback
mercredi 7 mars 2007
Par Gilles Jobin,
mercredi 7 mars 2007
:: Définitioneries
Je suis en train de lire
Le Machin de
Jacques Perret. C'est dans cette nouvelle qu'on trouve le mot
vistemboir.
En page 27 (éd. Gallimard/nrf, 1955), à la fin d'un paragraphe, on croise cette phrase :
« Ma loge n'est pas un pandémonhomme. »
J'avais Antidote sur un bureau. Silence complet.
J'ai googlé le mot. Silence encore plus bruyant - jusqu'à ce que le moteur trouve éventuellement mon billet. Dommage que le
googlewhacking exige un mot ou une combinaison de mots présents dans le dictionnaire. Il serait bien d'étendre la définition aux mots trouvés dans les romans.
8 commentaires
:: aucun trackback
mardi 24 octobre 2006
Par Gilles Jobin,
mardi 24 octobre 2006
:: Définitioneries
Dans
L'Homme singulier (1764) de
Destouches, on trouve à l'acte 3, scène 7 :
Un sage suit la mode, et tout bas il s'en moque;
Il déteste l'erreur, le vice, les abus,
Mais sans rompre en visière aux hommes corrompus.
Qu'est-ce que
rompre en visière ? Antidote nous répond :
rompre en visière avec qqn : le contredire avec force, en face.
Dans
Le dictionnaire de L'ACADÉMIE FRANÇAISE, 5ème Edition, 1798, on trouve une explication : « Rompre en visière, se disoit autrefois au propre, quand un Gendarme rompoit sa lance dans la visière de celui contre qui il couroit; et il signifie figurément, Attaquer, contredire quelqu'un en face, brusquement et violemment.
Il lui rompit en visière. »
aucun commentaire
:: aucun trackback
dimanche 9 avril 2006
Par Gilles Jobin,
dimanche 9 avril 2006
:: Définitioneries
Cet exercice est tiré de
Tester et enrichir son vocabulaire de
Paul Désalmand (Marabout, 1991). Il s'agit de dégager le sens général de ce court texte :
Je fus reçu par un vieillard ingambe qui se trouvait en proie à une grande alacrité. Il m'exprima non sans aménité et compendieusement qu'il n'y avait pas de solution de continuité entre son projet et le mien.
Pour vous aider, choisissez l'explication qui semble convenir aux mots en caractère gras du texte :
Ingambe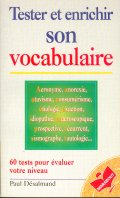
A. un peu dérangé du cerveau
B. marchant avec peine
C. privé d'une ou de deux jambes
D. plein d'entrain
E. peu enclin à s'amuser
Alacrité
A. entrain
B. mauvaise humeur
C. amertume
D. sécheresse de coeur
E. bonhomie
Aménité
A. aigreur
B. rudesse
C. amabilité
D. prétention
E. avidité
Compendieusement
A. solennellement
B. noblement
C. brièvement
D. avec une certaine lourdeur
E. en délayant beaucoup
Solution de continuité
A. relation de cause à effet
B. lien logique
C. rupture
D. harmonie
E. compatibilité
Bien sûr, vous pouvez vérifier vos réponses à l'aide de l'excellent
dictionnaire de synonymes du laboratoire de linguistique CRISCO. Mais, auparavant, prenez tout de même quelques minutes pour préciser, sans aide, votre compréhension du texte.
2 commentaires
:: aucun trackback
lundi 20 mars 2006
Par Gilles Jobin,
lundi 20 mars 2006
:: Définitioneries
« Mot créé de nos jours pour désigner d'une manière concise et énergique ce pouvoir étendu de simples commis, qui, dans différents bureaux, font passer une multitude de projets qu'ils forgent, ou qu'ils trouvent le plus souvent dans la poussière des bureaux, ou qu'ils protègent, soit par goût, soit par manie. »
(Jean-Sébastien Mercier, Néologie ou vocabulaire de mots nouveaux, 1801)
« Il n'y a personne qui n'ait eu à se plaindre soit de l'insolence, soit de l'ignorance, soit de la multitude des commis employés dans les bureaux à tailler des plumes et à obstruer la marche des affaires.
Jamais la bureaucratie ne fut portée à un point plus exagéré, plus dispendieux, plus fatigant. Jamais les affaires n'ont autant langui que depuis la création de cette armée de commis, qui sont au travail ce que les valets sont au service. Les consignes, les règlements, les enregistrements, les formalités de toute espèce ont été multipliés avec tant de profusion et si peu de discernement, que bien des gens, dégoûtés d'attendre leurs pensions et de solliciter leurs affaires, ont pris le parti d'y renoncer. »
(Jean-Sébastien Mercier, Nouveau Paris, 1798)
3 commentaires
:: aucun trackback
lundi 6 mars 2006
Par Gilles Jobin,
lundi 6 mars 2006
:: Définitioneries

« Qui vit de présens. On dit que les chefs de certains bureaux, sont tous plus ou moins des Dorophages ; mais, ainsi que M. Jourdain fesait de la prose sans le savoir, ils pratiquent, eux, la chose sans trop en connoître le nom; or les voilà bien avertis de leur titre. Allez trouver le Dorophage, agissez en conséquence, et votre affaire interminable sera terminée. Si ces chefs n'allaient plus porter d'autre nom, comme je rirais ! »
L. S. Mercier,
Néologie ou Vocabulaire de mots nouveaux, p. 197, Paris Moussard, 1801.
C'eût été bien si le juge Gomery en avait profité pour faire connaître ce très beau mot.
aucun commentaire
:: aucun trackback
vendredi 25 novembre 2005
Par Gilles Jobin,
vendredi 25 novembre 2005
:: Définitioneries
Vous trouverez
ici l'origine du mot
diariste. De là, il n'y a qu'un pas vers le néologisme
cyberdiariste. Dommage que ce mot soit si près d'un autre qui invariablement amènera la réflexion suivant : un blogue ne serait-il qu'une diarrhée cybernétique?

aucun commentaire
:: aucun trackback
jeudi 8 septembre 2005
Par Gilles Jobin,
jeudi 8 septembre 2005
:: Définitioneries
Portail scolaire : sanctuaire de la bonne conscience bureaucraTIC.
2 commentaires
:: un trackback
dimanche 7 août 2005
Par Gilles Jobin,
dimanche 7 août 2005
:: Définitioneries
On m'assure qu'en réalité peu de gens méditent sur leurs fins dernières en tapotant leur cigarette au bord de ces cupules cinéraires.
Jacques Perret, Les collectionneurs, Le Dilettante.
Cupule : n.f. Organe en forme de coupe qui entoure la base de certaines fleurs ou de certains fruits (gland, noisette, etc.) (Dictionnaire Quillet de la langue française, 1948)
Cinéraire : Qui renferme les cendres d'un mort. (op. cit.)
Quelle jolie image trouvée par Perret pour désigner un cendrier !
aucun commentaire
:: aucun trackback
dimanche 31 juillet 2005
Par Gilles Jobin,
dimanche 31 juillet 2005
:: Définitioneries
«Nous ferons place à la paralogie à côté de l'analogie et nous montrerons qu'à l'ancienne philosophie du comme si succède, en philosophie scientifique, la philosophie du pourquoi pas.»
Gaston Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, p. 10, PUF, 1934
Je n'ai trouvé aucune définition de ce mot. Cependant, paralogisme existe bel et bien. Étymologiquement, il vient du grec
para, «contre», et
logos, «discours», «raison».
Le paralogisme se rapproche du sophisme, bien qu'en général on utilise plus volontiers ce dernier mot pour désigner un raisonnement volontairement trompeur, le paralogisme étant commis de bonne foi (
La pratique de la philosophie, Hatier). Le paralogisme est un
raisonnement contraire à la logique ou entaché d'une erreur de démonstration (
Dictionnaire des mots rares et précieux, 10|18). Dans le Gradus : Les procédés littéraires (
B. Dupriez, 10|18),
le paralogisme est un sophisme, mais qui est de bonne foi.
Bachelard crée (?) le mot sans aucun doute pour « sonoriser » l'opposition avec le raisonnement par analogie. Le livre de Bachelard est un essai sur l'épistémologie de la science moderne. Fascinant !
2 commentaires
:: aucun trackback
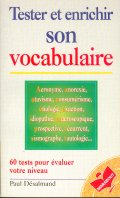 A. un peu dérangé du cerveau
A. un peu dérangé du cerveau « Qui vit de présens. On dit que les chefs de certains bureaux, sont tous plus ou moins des Dorophages ; mais, ainsi que M. Jourdain fesait de la prose sans le savoir, ils pratiquent, eux, la chose sans trop en connoître le nom; or les voilà bien avertis de leur titre. Allez trouver le Dorophage, agissez en conséquence, et votre affaire interminable sera terminée. Si ces chefs n'allaient plus porter d'autre nom, comme je rirais ! »
« Qui vit de présens. On dit que les chefs de certains bureaux, sont tous plus ou moins des Dorophages ; mais, ainsi que M. Jourdain fesait de la prose sans le savoir, ils pratiquent, eux, la chose sans trop en connoître le nom; or les voilà bien avertis de leur titre. Allez trouver le Dorophage, agissez en conséquence, et votre affaire interminable sera terminée. Si ces chefs n'allaient plus porter d'autre nom, comme je rirais ! »